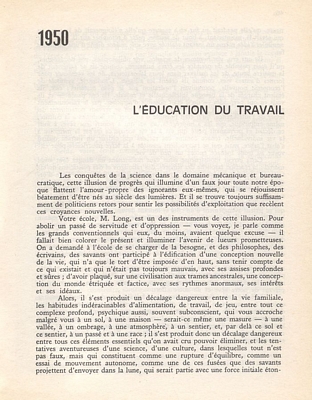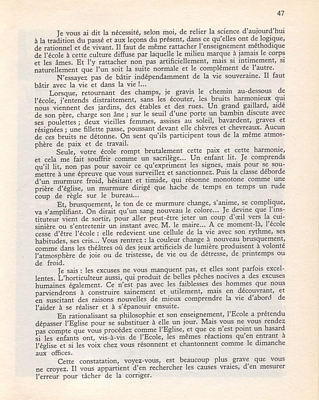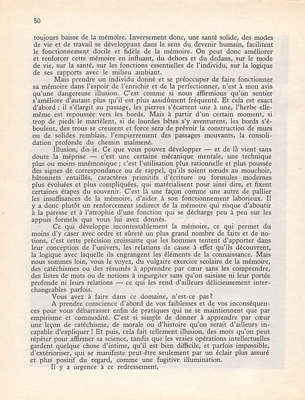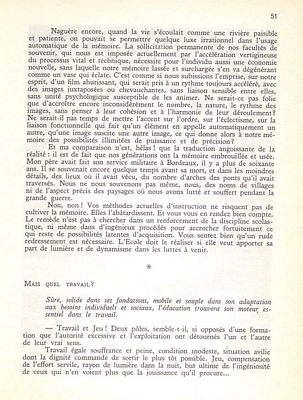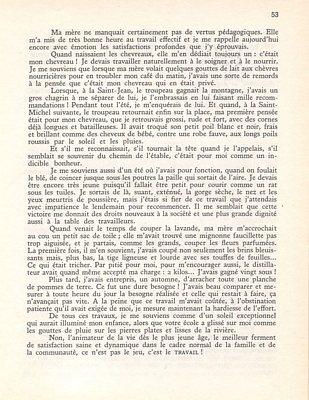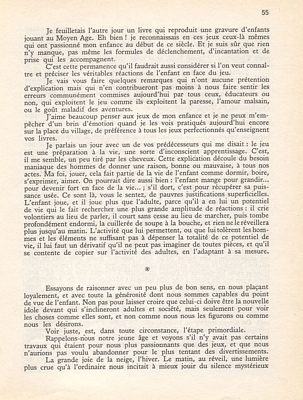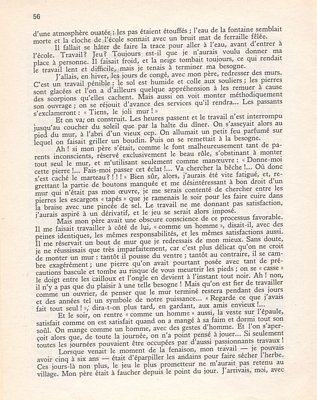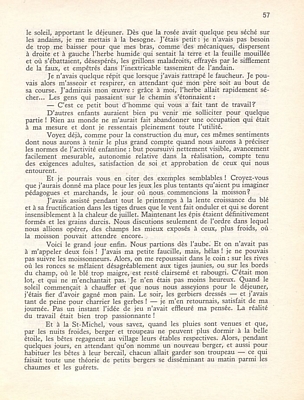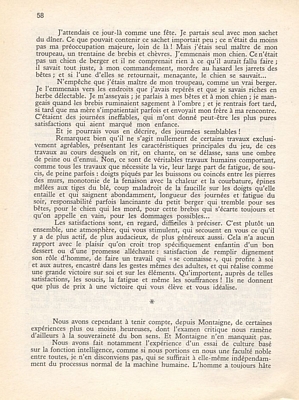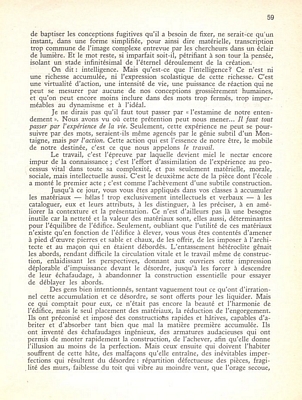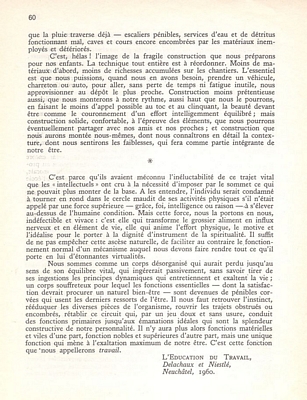1950
L’ÉDUCATION DU TRAVAIL
Les conquêtes de la science dans le domaine mécanique et bureaucratique, cette illusion de progrès qui illumine d’un faux jour toute notre époque flattent l’amour-propre des ignorants eux-mêmes, qui se réjouissent béatement d’être nés au siècle des lumières. Et il se trouve toujours suffisamment de politiciens retors pour sentir les possibilités d’exploitation que recèlent ces croyances nouvelles.
Votre école, M. Long, est un des instruments de cette illusion. Pour abolir un passé de servitude et d’oppression - vous voyez, je parle comme les grands conventionnels qui eux, du moins, avaient quelque excuse - il fallait bien colorer le présent et illuminer l’avenir de lueurs prometteuses. On a demandé à l’école de se charger de la besogne, et des philosophes, des écrivains, des savants ont participé à l’édification d’une conception nouvelle de la vie, qui n’a que le tort d’être imposée d’en haut, sans tenir compte de ce qui existait et qui n’était pas toujours mauvais, avec ses assises profondes et sûres ; d’avoir plaqué, sur une civilisation aux trames ancestrales, une conception du monde étriquée et factice, avec ses rythmes anormaux, ses intérêts et ses idéaux.
Alors, il s’est produit un décalage dangereux entre la vie familiale, les habitudes indéracinables d’alimentation, de travail, de jeu, entre tout ce complexe profond, psychique aussi, souvent subconscient, qui vous accroche malgré vous à un sol, à une maison - serait-ce même une masure - à une vallée, à un ombrage, à une atmosphère; à un sentier, et, par delà ce sol et ce sentier, à un passé et à une race ; il s’est produit donc un décalage dangereux entre tous ces éléments essentiels qu’on avait cru pouvoir éliminer, et les tentatives aventureuses d’une science, d’une culture, dans lesquelles tout n’est pas faux, mais qui constituent comme une rupture d’équilibre, comme un essai de mouvement autonome, comme une de ces fusées que des savants projettent d’envoyer dans la lune, qui serait partie avec une force initiale étonnante, qu’elle perdrait au fur et à mesure qu’elle s’éloignerait de la terre, et qui serait là, maintenant, à bout de souffle, prête à retomber sur la terre pour annihiler l’idée même un instant réalisée avec une audace digne d’une meilleure fin.
Ils ont cru, vos hommes de science, vos philosophes, vos pédagogues, qu’il était possible de prendre les êtres humains, comme ils se saisissent de la matière brute, de les malaxer dans leurs laboratoires, de les combiner pour former d’autres vies, comme ils créent les alliages. L’industrie, symbole de l’économie nouvelle, poursuivait l’opération sur le plan matériel ; eux, ils étaient chargés de la besogne intellectuelle et morale. Ils ont pensé - et ils vous en ont persuadés - qu’il était possible d’arracher, par le raisonnement pour ainsi dire, par la démonstration logique, en se servant notamment du levier de l’intelligence, qu’il était possible d’arracher les hommes à la culture, même empirique, qui les a imprégnés, au sol qui a nourri leur sève, à tout ce décisif et permanent passé qui est à la vie sociale ce qu’est la mémoire à la vie individuelle, tenace comme ces racines qui cèdent un instant quand s’abat l’arbre, mais qui se raccrochent aussitôt à la terre nourricière pour envoyer au tronc menacé encore un peu de vie.
Cette erreur monstrueuse nous vaut maintenant un danger tout aussi mortel : la réaction farouche des timorés, des rabougris et des politiciens qu’effraye le véritable progrès et qui voudraient nous faire croire que l’âge d’or, que nous n’avons pas su découvrir en avant, est derrière nous, que le progrès et la science ont fait faillite et qu’il faut se tourner vers le passé pour construire selon d’autres normes qui ne feraient que produire un nouveau décalage.
L’homme, espérons-le, saura agir autrement que ces bêtes traquées qui se jettent aveuglément d’un côté et foncent devant elles, mais qui, arrivées bientôt au bord d’un précipice, reculent effrayées pour se jeter avec le même aveuglement du côté opposé où elles se heurteront finalement à un précipice peut-être plus redoutable encore. Il ne suffit pas de rejeter en bloc ou la tradition ou le progrès, mais d’adapter intelligemment notre comportement aux nécessités de notre époque. Il faut que nous trouvions pour le proche avenir, des solutions qui s’appuient sur le présent réel, descendant et héritier du passé récent et de l’apport lointain des générations qui ont fertilisé notre sol, construit nos maisons, idéalisé notre langue et notre esprit. Le progrès doit se faire pour ainsi dire en fonction du passé, en évitant ce décalage dont nous avons mesuré les dangers, cette coupure qui nous a isolés de votre science, en la privant de notre sève et de notre effort.
L’École pourra beaucoup pour cela. Mais il lui faudra d’abord connaître et juger à sa mesure ce présent et ce passé, découvrir ce qu’ils portent en eux de dynamique et de constructif, et faire surgir aussi les grandes lignes de vie, les essentielles forces souterraines qui seront les leviers indispensables pour les créations qui s’imposent. Deux tâches également urgentes à mener avec méthode, mais aussi avec la notion exacte de notre humilité, de nos faiblesses et de nos grandeurs.
*
Je vous ai dit la nécessité, selon moi, de relier la science d’aujourd’hui à la tradition du passé et aux leçons du présent, dans ce qu’elles ont de logique, de rationnel et de vivant. Il faut de même rattacher l’enseignement méthodique de l’école à cette culture diffuse par laquelle le milieu marque à jamais le corps et les âmes. Et l’y rattacher non pas artificiellement, mais si intimement, si naturellement que l’un soit la suite normale et le complément de l’autre.
N’essayez pas de bâtir indépendamment de la vie souveraine. Il faut bâtir avec la vie et dans la vie !...
Lorsque, retournant des champs, je gravis le chemin au-dessous de l’école, j’entends distraitement, sans les écouter, les bruits harmonieux qui nous viennent des jardins, des étables et des rues. Un grand gaillard, aidé de son père, charge son âne ; sur le seuil d’une porte un bambin discute avec ses poulettes ; deux vieilles femmes, assises au soleil, bavardent, graves et résignées ; une fillette passe, poussant devant elle chèvres et chevreaux. Aucun de ces bruits ne détonne. On sent qu’ils participent tous de la même atmosphère de paix et de travail.
Seule, votre école rompt brutalement cette paix et cette harmonie, et cela me fait souffrir comme un sacrilège... Un enfant lit. Je comprends qu’il lit, non pas pour savoir ce qu’expriment les signes, mais pour se soumettre à une épreuve que vous surveillez et sanctionnez. Puis la classe déborde d’un murmure froid, hésitant et timide, qui résonne monotone comme une prière d’église, un murmure dirigé que hache de temps en temps un rude coup de règle sur le bureau...
Et, brusquement, le ton de ce murmure change, s’anime, se complique, va s’amplifiant. On dirait qu’un sang nouveau le colore... Je devine que l’instituteur vient de sortir, pour aller peut-être jeter un coup d’œil vers la cuisinière ou s’entretenir un instant avec M. le maire... A ce moment-là, l’école cesse d’être l’école : elle redevient une cellule de la vie avec son rythme, ses habitudes, ses cris... Vous rentrez : la couleur change à nouveau brusquement, comme dans les théâtres où des jeux artificiels de lumière produisent à volonté l’atmosphère de joie ou de tristesse, de vie ou de détresse, de printemps ou de froid.
Je sais : les excuses ne vous manquent pas, et elles sont parfois excellentes. L’horticulteur aussi, qui produit de belles pêches nocives a des excuses humaines également. Ce n’est pas avec les faiblesses des hommes que nous parviendrons à construire sainement et utilement, mais en découvrant, et en suscitant des raisons nouvelles de mieux comprendre la vie d’abord de l’aider à se réaliser et à s’épanouir ensuite.
En rationalisant sa philosophie et son enseignement, l’École a prétendu dépasser l’Église pour se substituer à elle un jour. Mais vous ne vous rendez pas compte que vous procédez comme l’Église, et que ce n’est point un hasard si les enfants ont, vis-à-vis de l’École, les mêmes réactions qu’en entrant à l’église et si les voix chez vous résonnent et chantonnent comme le dimanche aux offices.
Cette constatation, voyez-vous, est beaucoup plus grave que vous ne croyez. I1 vous appartient d’en rechercher les causes vraies, d’en mesurer l’erreur pour tâcher de la corriger.
L’école ne cultive pas la mémoire, elle la surcharge. Comment réagir ?
- Vous vous demandez pourquoi je suis à ce point sceptique sur vos possibilités de culture profonde ?
Vous parlez par exemple d’exercices réguliers de la mémoire.
Je vous ai déjà dit que l’École me paraît contribuer à un affaiblissement catastrophique de cette faculté.
Vous savez, il y a tout un art pour donner à manger l’hiver aux ânes et aux bœufs. Je ne parle pas des propriétaires dont la provision est si réduite qu’on touche déjà, à St-Joseph, la voûte inférieure de la grange, mais de ceux, plus cossus, qui ont à leur disposition des mottes de foin, hautes et tassées, qu’il faut couper à la faucille comme un gâteau généreux. Ceux-là pourraient jeter aux bêtes de belles brassées qui garniraient sans cesse un râtelier jamais totalement vide. Mais les bêtes s’habituent à cette profusion ; elles n’ont qu’un appétit réduit car elles ne sortent ni ne travaillent. Alors cette abondance de biens en vient à les rassasier d’avance, à les rebuter, à les fatiguer ; elles mordent du bout des dents, fouillant sans raison de leur nez trop gourmand, pour chercher on ne sait quoi d’ailleurs. Elles traînent, salissent, renversent le foin qui s’en va en inutile litière.
Donnez-leur au contraire tout juste ce que nécessitent leurs besoins corporels, ce que désire leur appétit ; enseignez-leur à attendre, à souhaiter, à manger ensuite sans gaspillage. Vous aurez des bêtes mieux portantes.
Vous avez été trop souvent ces patrons orgueilleux de la richesse de leur grange et qui voudraient en faire bénéficier au maximum les individus dont ils ont la charge ; qui se félicitent de l’ampleur des brassées qui franchis sent la trappe, sans se préoccuper ni du gaspillage ni du rassasiement prématuré. Votre grange est pleine et vous devez la vider avant l’août pour la récolte prochaine. Vous vous plaignez de même de l’inappétence de vos élèves, de la faiblesse d’une mémoire que vous fatiguez par un exercice exagéré, conduit dans des conditions défectueuses.
Je n’ignore pas que la question préoccupe les pédagogues qui se sont rendu compte qu’à vouloir seulement forcer la mémoire comme un vase qu’on remplit suscite une fatigue qui n’est que la réaction de défense de l’organisme malmené, et que cette fatigue disparaît lorsque l’enfant s’intéresse à ce qui se présente à lui sous une forme répondant à ses besoins profonds.
Mais l’école se rend difficilement à cette évidence; ou plutôt elle ne l’admet point. Parce que, malgré cette inappétence, malgré cette fatigue, les enfants de notre siècle connaissent incontestablement beaucoup plus de choses que les enfants d’il y a cent ou deux cents ans, on en conclut que l’école a tout de même développé la mémoire, et qu’elle a raison de ne pas tourner le dos à des techniques qui ont fait leurs preuves.
Or, je me demande, moi, si la mémoire est vraiment une faculté qui soit susceptible de se perfectionner et de s’améliorer, du moins par les moyens directs habituels. La mémoire se présente comme une possibilité individuelle qui est une fonction pour ainsi dire préétablie par les conditions physiologiques et mentales que nous portons en nous. Si ces conditions sont défavorables, si elles nuisent au fonctionnement harmonieux de l’organisme, il y a presque toujours baisse de la mémoire. Inversement donc, une santé solide, des modes de vie et de travail se développant dans le sens du devenir humain, facilitent le fonctionnement docile et fidèle de la mémoire. On peut donc améliorer et renforcer cette mémoire en influant, du dehors et du dedans, sur le mode de vie, sur la santé, sur les fonctions essentielles de l’individu, sur la logique de ses rapports avec le milieu ambiant.
Mais prendre un individu donné et se préoccuper de faire fonctionner sa mémoire dans l’espoir de l’enrichir et de la perfectionner, n’est à mon avis qu’une dangereuse illusion. C’est comme si nous affirmions qu’un sentier s’améliore d’autant plus qu’il est plus assidûment fréquenté. Et cela est exact d’abord : il s’élargit au passage, les pierres s’écartent une à une, l’herbe elle-même est repoussée vers les bords. Mais à partir d’un certain moment, si trop de pieds le martèlent, si de lourdes bêtes s’y aventurent, les bords s’éboulent, des trous se creusent et force sera de prévoir la construction de murs ou de solides remblais, l’empierrement des passages mouvants, la consolidation profonde du chemin malmené.
Illusion, dis-je. Ce que vous pouvez développer - et de là vient sans doute la méprise - c’est une certaine mécanique mentale, une technique plus ou moins mnémonique ; c’est l’utilisation plus rationnelle et plus poussée des signes de correspondance ou de rappel, qu’ils soient nœuds au mouchoir, bâtonnets entaillés, caractères primitifs d’écriture ou formules modernes plus évoluées et plus compliquées, qui matérialisent pour ainsi dire, et fixent certaines étapes du souvenir. C’est là une façon comme une autre de pallier les insuffisances de la mémoire, d’aider à son fonctionnement laborieux. Il y a donc plutôt un renforcement indirect de la mémoire qui risque d’aboutir à la paresse et à l’atrophie d’une fonction qui se décharge peu à peu sur les appuis formels que vous lui avez donnés.
Ce qui développe incontestablement la mémoire, ce qui permet du moins d’y caser avec ordre et sûreté un plus grand nombre de faits et de notions, c’est cette précision croissante que les hommes tentent d’apporter dans leur conception de l’univers, les relations de cause à effet qu’ils découvrent, la logique avec laquelle ils engrangent les éléments de la connaissance. Mais nous sommes loin, vous le voyez, du vulgaire exercice scolaire de la mémoire, des catéchismes ou des résumés à apprendre par cœur sans les comprendre, des listes de mots ou de notions à ingurgiter sans qu’on saisisse ni leur portée profonde ni leurs relations - ce qui les rend d’ailleurs délicieusement interchangeables parfois.
Vous avez à faire dans ce domaine, n’est-ce pas ?
A prendre conscience d’abord de vos faiblesses et de vos inconséquences pour vous débarrasser enfin de pratiques qui ne se maintiennent que par empirisme et commodité. C’est si simple de donner à apprendre par cœur une leçon de catéchisme, de morale ou d’histoire qu’on serait d’ailleurs incapable d’expliquer ! Et puis, cela fait tellement illusion, des mots qu’on peut répéter pour affirmer sa science, tandis que les vraies opérations intellectuelles gardent quelque chose d’intime, qu’il est bien difficile, et parfois impossible, d’extérioriser, qui se manifeste peut-être seulement par un éclair plus assuré et plus positif du regard, comme une fugitive illumination.
Il y a urgence à ce redressement.
Naguère encore, quand la vie s’écoulait comme une rivière paisible et patiente, on pouvait se permettre quelque luxe irrationnel dans l’usage automatique de la mémoire. La sollicitation permanente de nos facultés de souvenir, qui nous est imposée actuellement par l’accélération vertigineuse du processus vital et technique, nécessite pour l’individu aussi une économie nouvelle, sans laquelle notre mémoire lassée et surchargée s’en va dégénérant comme un vase qui éclate. C’est comme si nous subissions l’emprise, sur notre esprit, d’un film ahurissant, qui serait pris à un rythme toujours accéléré, avec des images juxtaposées ou chevauchantes, sans liaison sensible entre elles, sans unité psychologique susceptible de les animer. Ne serait-ce pas folie que d’accroître encore inconsidérément le nombre, la nature, le rythme des images, sans penser à leur cohésion et à l’harmonie de leur déroulement ? Ne serait-il pas temps de mettre l’accent sur l’ordre, sur l’éclectisme, sur la liaison fonctionnelle qui fait qu’un élément en appelle automatiquement un autre, qu’une image suscite une autre image, ce qui donne alors à notre mémoire des possibilités illimitées de puissance et de précision ?
Et ma comparaison n’est, hélas ! que la traduction angoissante de la réalité : il est de fait que nos générations ont la mémoire embrouillée et usée. Mon père avait fait son service militaire à Bordeaux, il y a plus de soixante ans. Il se souvenait encore quelque temps avant sa mort, et dans les moindres détails, des lieux où il avait vécu, du nombre d’arches des ponts qu’il avait traversés. Nous ne nous souvenons pas même, nous, des noms de villages ni de l’aspect précis des paysages où nous avons lutté et souffert pendant la grande guerre.
Non, non ! Vos méthodes actuelles d’instruction ne risquent pas de cultiver la mémoire. Elles l’abâtardissent. Et vous vous en rendez bien compte. Le remède n’est pas à chercher dans un renforcement de la discipline scolastique, ni même dans d’ingénieux procédés pour accrocher fortuitement ce qui reste de possibilités latentes d’acquisition. Vous sentez bien qu’un rude redressement est nécessaire. L’École doit le réaliser si elle veut apporter sa part de lumière et de dynamisme dans les luttes à venir.
*
MAIS QUEL TRAVAIL ?
Sûre, solide dans ses fondations, mobile et souple dans son adaptation aux besoins individuels et sociaux, l’éducation trouvera son moteur, essentiel dans le travail.
- Travail et jeu ! Deux pôles, semble-t-il, si opposés d’une formation que l’autorité excessive et l’exploitation ont détournés l’un et l’autre de leur vrai sens.
Travail égale souffrance et peine, condition modeste, situation avilie dont la dignité commande de sortir le plus tôt possible. Jeu, compensation de l’effort servile, rayon de lumière dans la nuit, but ultime de l’ingéniosité de ceux qui n’en voient plus que la jouissance qu’il procure...
Ma mère ne manquait certainement pas de vertus pédagogiques. Elle m’a mis de très bonne heure au travail effectif et je me rappelle aujourd’hui encore avec émotion les satisfactions profondes que j’y éprouvais.
Quand naissaient les chevreaux, elle m’en dédiait toujours un : c’était mon chevreau ! Je devais travailler naturellement à le soigner et à le nourrir. Je me souviens que lorsque ma mère volait quelques gouttes de lait aux chèvres nourricières pour en troubler mon café du matin, j’avais une sorte de remords à la pensée que c’était mon chevreau qui en était privé.
Lorsque, à la Saint-Jean, le troupeau gagnait la montagne, j’avais un gros chagrin à me séparer de lui, je l’embrassais en lui faisant mille recommandations ! Pendant tout l’été, je m’enquérais de lui. Et quand, à la Saint-Michel suivante, le troupeau retournait enfin sur la place, ma première pensée était pour mon chevreau, que je retrouvais grossi, rude et fort, avec des cornes déjà longues et batailleuses. Il avait troqué son petit poil blanc et noir, frais et brillant comme des cheveux de bébé, contre une robe fauve, aux longs poils roussis par le soleil et les pluies.
Et s’il me reconnaissait, s’il tournait la tête quand je l’appelais, s’il semblait se souvenir du chemin de l’étable, c’était pour moi comme un indicible bonheur.
Je me souviens aussi d’un été où j’avais pour fonction, quand on foulait le blé, de coincer jusque sous les poutres la paille qui sortait de l’aire. Je devais être encore très jeune puisqu’il fallait être petit pour courir comme un rat sous les tuiles. Je sortais de là, suant, exténué, la gorge sèche, le nez et les yeux meurtris de poussière, mais j’étais si fier de ce travail que j’attendais avec impatience le lendemain pour recommencer. Il me semblait que cette victoire me donnait des droits nouveaux à la société et une plus grande dignité aussi à la table des travailleurs.
Quand venait le temps de couper la lavande, ma mère m’accrochait au cou un petit sac de toile ; elle m’avait trouvé une mignonne faucillette pas trop aiguisée, et je partais, comme les grands, couper les fleurs parfumées. La première fois, il m’en souvient, j’avais coupé non seulement les brins bleuissants mais, plus bas, la tige ligneuse et lourde avec ses touffes de feuilles... Ce qui était tricher. Par pitié pour moi, pour m’encourager aussi, le distillateur avait quand même accepté ma charge : 2 kilos... J’avais gagné vingt sous !
Plus tard, j’avais entrepris, un automne, d’arracher toute une planche de pommes de terre. Ce fut une dure besogne ! J’avais beau comparer et mesurer à toute heure du jour la besogne réalisée et celle qui restait à faire, ça n’avançait pas vite. A la peine que ce travail m’avait coûtée, à l’obstination patiente qu’il avait exigée de moi, je mesure maintenant la hardiesse de l’effort. De tous ces travaux, je me souviens comme d’un soleil exceptionnel qui aurait illuminé mon enfance, alors que votre école a glissé sur moi comme les gouttes de pluie sur les pierres plates et lisses de 1a rivière.
Non, l’animateur de la vie dès le plus jeune âge, le meilleur ferment de satisfaction saine et dynamique dans le cadre normal de la famille et de la communauté, ce n’est pas le jeu, c’est le TRAVAIL !
I1 y a un jeu pour ainsi dire « fonctionnel », qui s’exerce dans le sens des besoins individuels et sociaux de l’enfant et de l’homme, un jeu qui prend ses racines au plus profond du devenir ancestral, et qui, indirectement peut être, reste comme une préparation essentielle à la vie, une éducation qui se poursuit mystérieusement, instinctivement, non pas sur le mode analytique, raisonnable, et dogmatique de la scolastique, mais dans un esprit, par une logique, selon un processus qui semblent être spécifiques à la nature de l’enfant.
Ce jeu, qui est essentiel, au petit animal comme au petit homme, c’est, en définitive du travail, mais du travail d’enfant, dont nous ne saisissons pas toujours le but, que nous ne reconnaissons aucunement parce qu’il est moins terre à terre, moins bassement utilitaire que nous l’imaginons communément. Pour l’enfant, ce travail-jeu est une sorte d’explosion et de libération, comme en ressent encore, de nos jours, l’homme qui parvient à se donner à une tâche profonde qui l’anime et le divinise.
Je sais qu’on a formulé à propos du jeu toutes sortes de systèmes explicatifs qui, comme les systèmes philosophiques, se contredisent et se détruisent réciproquement. Là encore, on a examiné superficiellement, sans s’attaquer au problème réel, lié à tout le processus dynamique de l’enfant, motivé par le passé ancestral, éclairé par les lueurs subconscientes d’avenir.
Dans ces études, dont je ne nie pas qu’elles puissent être très consciencieuses, on a oublié, à mon avis, l’essentiel - si mystérieux, il est vrai - pour glisser paresseusement vers une conception dégénérée du jeu-travail. On a négligé, dans le jeu, cet élan d’adaptation et de libération pour ne garder que le plaisir euphorique qu’il procure.
Et c’est sur ce plaisir, sur cette euphorie, que les pédagogues ont étayé leurs théories. On pourrait presque dire que, dès lors, cette pédagogie moderne dont vous me parlez a été fondée non plus sur le jeu véritable, mais sur le plaisir, ce qui est une tout autre affaire.
Le jeu traditionnel de l’enfant est créateur et dynamique. Le plaisir qu’il procure est d’une qualité toute spéciale, qui n’est pas sans rapport cependant avec la jouissance organique, qu’elle soit digestive ou sexuelle. C’est comme une vibration qui secoue l’individu et tend à lui donner une plus grande amplitude, qui lui fait prendre conscience de ses possibilités et de sa puissance, qui lui permet de se mesurer avec le monde ambiant. Je ne considère pas ici les jeux inventés de fraîche date par des hommes pervertis en ce sens qu’ils ont perdu le contact avec les destinées profondes des individus, hypertrophié et déformé des tendances dont l’exaspération sert leurs appétits d’exploitation égoïste.
Vous ne comprenez peut-être pas suffisamment la distinction que je tiens à faire et qui est pourtant indispensable à toute étude rationnelle de cette question du jeu. Vous êtes jeune encore, mais vous m’avez dit avoir été élevé dans un village. Vous savez alors que les jeux sont parmi les coutumes qui ont le mieux défié le temps ; je dirais même que ce sont les seules qui se transmettent merveilleusement, et sans changement notable, à travers les siècles.
Je feuilletais l’autre jour un livre qui reproduit une gravure d’enfants jouant au Moyen Âge. Et bien ! je reconnaissais en ces jeux ceux-là mêmes qui ont passionné mon enfance au début de ce siècle. Et je suis sûr que rien n’y manque, pas même les formules de déclenchement, d’incantation et de prise qui les accompagnent.
C’est cette permanence qu’il faudrait aussi considérer si l’on veut connaître et préciser les véritables réactions de l’enfant en face du jeu.
Je vais vous faire quelques remarques qui n’ont aucune prétention d’explication mais qui n’en contribueront pas moins à nous faire sentir les erreurs communément commises aujourd’hui par tous ceux, éducateurs ou non, qui exploitent le jeu comme ils exploitent la paresse, l’amour malsain, ou le goût maladif des aventures.
J’aime beaucoup penser aux jeux de mon enfance et je ne peux m’empêcher d’un brin d’émotion quand je les vois pratiqués aujourd’hui encore sur la place du village, de préférence à tous les jeux perfectionnés qu’enseignent vos livres.
Je parlais un jour avec un de vos prédécesseurs qui me disait : le jeu est une préparation à la vie, une sorte d’inconscient apprentissage. C’est, il me semble, un peu tiré par les cheveux. Cette explication découle du besoin maniaque des hommes de donner une raison, bonne ou mauvaise, à tous nos actes. Ma foi, jouer, cela fait partie de la vie de l’enfant comme dormir, boire, s’exprimer, aimer. On pourrait dire aussi bien : l’enfant mange pour grandir... pour devenir fort en face de la vie... ; s’il dort, c’est pour récupérer sa puissance usée. Ce sont là, vous le sentez, de pauvres justifications superficielles. L’enfant joue, et il joue plus que l’adulte, parce qu’il a en lui un potentiel de vie qui le fait rechercher une plus grande amplitude de réactions : il crie volontiers au lieu de parler, il court sans cesse au lieu de marcher, puis tombe profondément endormi, la cuillerée de soupe à la bouche, et rien ne le réveillera plus jusqu’au matin. L’activité que lui permettent, ou que lui tolèrent les hommes et les éléments ne suffisant pas à dépenser la totalité de ce potentiel de vie, il lui faut un dérivatif qu’il ne peut pas imaginer de toutes pièces, et qu’il se contente de copier sur l’activité des adultes, en l’adaptant à sa mesure.
*
Essayons de raisonner avec un peu plus de bon sens, en nous plaçant loyalement, et avec toute la générosité dont nous sommes capables du point de vue de l’enfant. Non pas pour laisser croire que celui-ci doive être la nouvelle idole devant qui s’inclineront adultes et société, mais seulement pour voir les choses comme elles sont, et non comme nous nous les figurons ou comme nous les désirons.
Voir juste, est, dans toute circonstance, l’étape primordiale. Rappelons-nous notre jeune âge et voyons s’il n’y avait pas certains travaux qui étaient pour nous plus passionnants que des jeux, et que nous n’aurions pas voulu abandonner pour le plus tentant des divertissements. La grande joie de la neige, l’hiver. Le matin, au réveil, une lumière plus crue qu’à l’ordinaire nous incitait à mieux jouir du silence mystérieux d’une atmosphère ouatée : les pas étaient étouffés ; l’eau de la fontaine semblait morte et la. cloche de l’école sonnait avec un bruit mat de ferraille fêlée.
Il fallait se hâter de faire la trace pour aller à l’eau, avant d’entrer à l’école. Travail ? Jeu ? Toujours est-il que je n’aurais voulu donner ma place à personne. Il faisait froid, et la neige tombait toujours, ce qui rendait le travail lent et difficile, mais je tenais à terminer ma besogne.
J’allais, en hiver, les jours de congé, avec mon père, redresser des murs. C’est un travail pénible : le sol est humide et colle aux souliers ; les pierres sont glacées et l’on a d’ailleurs quelque appréhension à les remuer à cause des scorpions qu’elles cachent. Mais aussi on voit monter méthodiquement son ouvrage ; on se réjouit d’avance des services qu’il rendra... Les passants s’exclameront : « Tiens, le joli mur ! »
Et on va ; on construit. Les heures passent et le travail n’est interrompu jusqu’au coucher du soleil que par la halte du dîner. On s’asseyait alors au pied du mur, à l’abri d’un vieux cep. On allumait un petit feu parfumé sur lequel on faisait griller un boudin. Puis on se remettait à la besogne.
Ah ! si mon père s’était, comme le font malheureusement tant de parents inconscients, réservé exclusivement le beau rôle, s’obstinant à monter tout seul le mur, et m’utilisant seulement comme manœuvre : « Donne-moi cette pierre !... Fais-moi passer cet éclat !... Va chercher la bêche !... Où donc s’est caché le marteau ?!!! » Bien sûr, alors, j’aurais été vite fatigué, et, regrettant la. partie de boutons manquée et me désintéressant à bon droit d’un mur qui n’était pas mon oeuvre, je me serais contenté de chercher entre les pierres les escargots « tapés » que je ramenais le soir pour les faire cuire dans la braise avec une pincée de sel. Le travail ne me donnant pas satisfaction, j’aurais aspiré à un dérivatif, et le jeu se serait alors imposé.
Mais mon père avait une obscure conscience de ce processus favorable. Il me faisait travailler à côté de lui, « comme un homme », disait-il, avec des peines identiques, les mêmes responsabilités, et les mêmes satisfactions aussi. Il me réservait un bout de mur que je redressais de mon mieux. Sans doute, je ne réussissais que très imparfaitement, car c’est plus délicat qu’on ne croit de monter un mur : tantôt il pousse du ventre ; tantôt au contraire, il se cambre exagérément; une pierre qu’on avait pourtant posée avec tant de précautions bascule et tombe au risque de vous meurtrir les pieds ; on se « casse » le doigt entre les cailloux et l’ongle en devient à l’instant tout noir. Ah ! non, il n’y a pas que du plaisir à une telle besogne ! Mais qu’on est fier de travailler comme un ouvrier, de penser que le mur terminé restera pendant des jours et des années tel un symbole de notre puissance... « Regarde ce que j’avais fait tout seul ! », dira-t-on plus tard, en gardant, aux amis envieux !...
Et le soir, on rentre « comme un homme » aussi, la veste sur l’épaule, satisfait comme on est satisfait quand on a mangé à sa faim et dormi tout son soûl. On mange comme un homme, avec des gestes d’homme. Et l’on s’aperçoit alors que, de toute la journée, on n’a point pensé à jouer... Si seulement toutes les journées pouvaient être occupées par d’aussi passionnants travaux ! Lorsque venait le moment de la fenaison, mon travail - je pouvais avoir cinq à six ans - était d’éparpiller les andains pour faire sécher l’herbe. Ces jours-là non plus, le jeu le plus prometteur ne m’aurait pas retenu au village. Mon père était à faucher depuis le point du jour. J’arrivais, moi, avec le soleil, apportant le déjeuner. Dès que la rosée avait quelque peu séché sur les andains, je me mettais à la besogne. J’étais petit : je n’avais pas besoin de trop me baisser pour que mes bras, comme des mécaniques, dispersent à droite et à gauche l’herbe humide qui sentait la terre et la feuille mouillée et où s’ébattaient, désespérés, les grillons maladroits, effrayés par le sifflement de la faux, et empêtrés dans l’inextricable tassement de l’andain.
Je n’avais quelque répit que lorsque j’avais rattrapé le faucheur. Je pouvais alors m’asseoir et respirer, en attendant que mon père soit au bout de sa course. J’admirais mon œuvre : grâce à moi, l’herbe allait rapidement sécher... Les gens qui passaient sur le chemin s’étonnaient:
- C’est ce petit bout d’homme qui vous a fait tant de travail ? D’autres enfants auraient bien pu venir me solliciter pour quelque partie ! Rien au monde ne m’aurait fait abandonner une occupation qui était à ma mesure et dont je ressentais pleinement toute l’utilité.
Voyez déjà, comme pour la construction du mur, ces mêmes sentiments dont nous aurons à tenir le plus grand compte quand nous aurons à préciser les normes de l’activité enfantine : but poursuivi nettement visible, avancement facilement mesurable, autonomie relative dans la réalisation, compte tenu des exigences adultes, satisfaction de soi et approbation de ceux qui nous entourent.
Et je pourrais vous en citer des exemples semblables ! Croyez-vous que j’aurais donné ma place pour les jeux les plus tentants qu’aient pu imaginer pédagogues et marchands, le jour où nous commencions la moisson ?
J’avais assisté pendant tout le printemps à la lente croissance du blé et à sa fructification dans les tiges drues que le vent fait onduler et qui se dorent insensiblement à la chaleur de juillet. Maintenant les épis étaient définitivement formés et les grains durcis. Nous discutions seulement de l’ordre dans lequel nous allions opérer, des champs les mieux exposés à ceux, plus froids, où la moisson pouvait attendre encore.
Voici le grand jour enfin. Nous partions dès l’aube. Et on n’avait pas à m’appeler deux fois ! J’avais ma petite faucille, mais, hélas ! je ne pouvais pas suivre les moissonneurs. Alors, on me repoussait dans le coin: sur les rives où les ronces se mêlaient désagréablement aux tiges jaunies, ou sur les bords du champ, où le blé trop maigre, est resté clairsemé et rabougri. C’était mon lot, et qui ne m’enchantait pas. Je n’en étais pas moins heureux. Quand le soleil commençait à chauffer et que nous nous asseyions pour le déjeuner, j’étais fier d’avoir gagné mon pain. Le soir, les gerbiers dressés - et j’avais tant de peine pour charrier les gerbes ! - je m’en retournais, satisfait de ma journée. Pas un instant l’idée de jeu n’avait effleuré ma pensée. La réalité du travail était bien trop passionnante !
Et à la St-Michel, vous savez, quand les pluies sont venues et que, par les nuits froides, berger et troupeau ne peuvent plus dormir à la belle étoile, les bêtes regagnent au village leurs étables respectives. Alors, pendant quelques jours, en attendant qu’on nomme un nouveau berger, et aussi pour habituer les bêtes à leur bercail, chacun allait garder son troupeau - ce qui faisait toute une théorie de petits bergers se disséminant au matin parmi les chaumes et les guérets.
J’attendais ce jour-là comme une fête. Je partais seul avec mon sachet du dîner. Ce que pouvait contenir ce sachet importait peu ; ce n’était du moins pas ma préoccupation majeure, loin de là ! Mais j’étais seul maître de mon troupeau, une trentaine de brebis et chèvres. J’emmenais mon chien. Ce n’était pas un chien de berger et il ne comprenait rien à ce qu’il aurait fallu faire ; il savait tout juste, à mon commandement, mordre au hasard les jarrets des bêtes et si l’une d’elles se retournait, menaçante, le chien se sauvait...
N’empêche que j’étais maître de mon troupeau, comme un vrai berger. Je l’emmenais vers les endroits que j’avais repérés et que je savais riches en herbe délectable. Je m’asseyais; je parlais à mes bêtes et à mon chien ; je mangeais quand les brebis ruminaient sagement à l’ombre; et je rentrais fort tard, si tard, que ma mère s’impatientait parfois et envoyait mon frère à ma rencontre. C’étaient des journées ineffables, qui m’ont donné peut-être les plus pures satisfactions qui aient marqué mon enfance.
Et je pourrais vous en décrire, des journées semblables ! Remarquez bien qu’il ne s’agit nullement de certains travaux exclusivement agréables, présentant les caractéristiques principales du jeu, de ces travaux au cours desquels on rit, on chante, on se délasse, sans une ombre de peine ou d’ennui. Non, ce sont de véritables travaux humains comportant, comme tous les travaux que nécessite la vie, leur large part de fatigue, de soucis, de peine parfois : doigts piqués par les buissons ou coincés entre les pierres des murs, monotonie de la fenaison avec la chaleur et la courbature, épines mêlées aux tiges du blé, coup maladroit de la faucille sur les doigts qu’elle entaille et qui saignent abondamment, longueur des journées et fatigue du soir, responsabilité parfois lancinante du petit berger qui tremble pour ses bêtes, pour le chien qui les mord, pour cette brebis qui s’écarte toujours et qu’on appelle en vain, pour les dommages possibles...
Les satisfactions sont, en regard, difficiles à préciser. C’est plutôt un ensemble, une atmosphère, qui vous stimulent, qui secouent en vous ce qu’il y a de plus actif, de plus audacieux, de plus généreux aussi. Cela n’a aucun rapport avec le plaisir qu’on croit trop spécifiquement enfantin d’un bon dessert ou d’une promesse alléchante: satisfaction de remplir dignement son rôle d’homme, de faire un travail qui « se connaisse », qui profite à soi et aux autres, encastré dans les gestes mêmes des adultes, et qui réalise comme une grande victoire sur soi et sur les éléments. Qu’importent, auprès de telles satisfactions, les soucis, la fatigue et même les souffrances ! Ils ne donnent que plus de prix à une victoire qui vous élève et vous idéalise.
*
Nous avons cependant à tenir compte, depuis Montaigne, de certaines expériences plus ou moins heureuses, dont l’examen critique nous ramène d’ailleurs à la souveraineté du bon sens. Et Montaigne n’en manquait pas.
Nous avons fait notamment l’expérience d’un essai de culture basé sur la fonction intelligence, comme si nous portions en nous une faculté noble entre toutes, je n’en disconviens pas, qui se suffirait à elle-même indépendamment du processus normal de la machine humaine. L’homme a toujours hâte de baptiser les conceptions fugitives qu’il a besoin de fixer, ne serait-ce qu’un instant, dans une forme simplifiée, pour ainsi dire matérielle, transcription trop commune de l’image complexe entrevue par les chercheurs dans un éclair de lumière. Et le mot reste, si imparfait soit-il, pétrifiant à son tour la pensée, isolant un stade infinitésimal de l’éternel déroulement de la création.
On dit : intelligence. Mais qu’est-ce que l’intelligence ? Ce n’est ni une richesse accumulée, ni l’expression scolastique de cette richesse. C’est une virtualité d’action, une intensité de vie, une puissance de réaction qui ne peut se mesurer par aucune de nos conceptions grossièrement humaines, et qu’on peut encore moins inclure dans des mots trop fermés, trop imperméables au dynamisme et à l’idéal.
Je ne dirais pas qu’il faut tout passer par « l’estamine de notre entendement ». Nous avons vu où cette prétention peut nous mener... Il faut tout passer par l’expérience de la vie. Seulement, cette expérience ne peut se pour suivre par des mots, seraient-ils même agencés par le génie subtil d’un Montaigne, mais par l’action. Cette action qui est l’essence de notre être, le mobile de notre destinée, c’est ce que nous appelons le travail.
Le travail, c’est l’épreuve par laquelle devient miel le nectar encore impur de la connaissance ; c’est l’effort d’assimilation de l’expérience au processus vital dans toute sa complexité, et pas seulement matérielle, morale, sociale, mais intellectuelle aussi. C’est le deuxième acte de la pièce dont l’école a monté le premier acte; c’est comme l’achèvement d’une subtile construction. Jusqu’à ce jour, vous vous êtes appliqués dans vos classes à accumuler les matériaux – hélas ! trop exclusivement intellectuels et verbaux - à les cataloguer, eux et leurs attributs, à les distinguer, à les préciser, à en améliorer la contexture et la présentation. Ce n’est d’ailleurs pas là une besogne inutile car la netteté et la valeur des matériaux sont, elles aussi, déterminantes pour l’équilibre de l’édifice. Seulement, oubliant que l’utilité de ces matériaux n’existe qu’en fonction de l’édifice à élever, vous vous êtes contentés d’amener à pied d’œuvre pierres et sable et chaux, de les offrir, de les imposer à l’architecte et au maçon qui en étaient débordés. L’entassement hétéroclite gênait les abords, rendant difficile la circulation vitale et le travail même de construction, enlaidissant les perspectives, donnant aux ouvriers cette impression déplorable d’impuissance devant le désordre, jusqu’à les forcer à descendre de leur échafaudage, à abandonner la construction essentielle pour essayer de déblayer les abords.
Des gens bien intentionnés, sentant vaguement tout ce qu’ont d’irrationnel cette accumulation et ce désordre, se sont offerts pour les liquider. Mais ce qui comptait pour eux, ce n’était pas encore la beauté et l’harmonie de l’édifice, mais le seul placement des matériaux, la réduction de l’engorgement. Ils ont préconisé et imposé des constructions rapides et hâtives, capables d’abriter et d’absorber tant bien que mal la matière première accumulée. Ils ont inventé des échafaudages ingénieux, des armatures audacieuses qui ont permis de monter rapidement la construction, de l’achever, afin qu’elle donne l’illusion au moins de la perfection. Mais ceux ensuite qui doivent l’habiter souffrent de cette hâte, des malfaçons qu’elle entraîne, des inévitables imperfections qui résultent du désordre: répartition défectueuse des pièces, fragilité des murs, faiblesse du toit qui vibre au moindre vent, que l’orage secoue, que la pluie traverse déjà - escaliers pénibles, services d’eau et de détritus fonctionnant mal, caves et cours encore encombrées par les matériaux inemployés et détériorés.
C’est, hélas ! l’image de la fragile construction que nous préparons pour nos enfants. La technique tout entière est à réordonner. Moins de matériaux d’abord, moins de richesses accumulées sur les chantiers. L’essentiel est que nous puissions, quand nous en avons besoin, prendre un véhicule, charreton ou auto, pour aller, sans perte de temps ni fatigue inutile, nous approvisionner au dépôt le plus proche. Construction moins prétentieuse aussi, que nous monterons à notre rythme, aussi haut que nous le pourrons, en faisant le moins d’appel possible au toc et au clinquant, la beauté devant être comme le couronnement d’un effort intelligemment équilibré ; mais construction solide, confortable, à l’épreuve des éléments, que nous pourrons éventuellement partager avec nos amis et nos proches; et construction que nous aurons montée nous-mêmes, dont nous connaîtrons en détail la contexture, dont nous sentirons les faiblesses, qui fera comme partie intégrante de notre être.
*
C’est parce qu’ils avaient méconnu l’inéluctabilité de ce trajet vital que les « intellectuels » ont cru à la nécessité d’imposer par le sommet ce qui ne pouvait plus monter de la base. A les entendre, l’individu serait condamné à tourner en rond dans le cercle maudit de ses activités physiques s’il n’était appelé par une force supérieure - grâce, foi, intelligence ou raison -.à s’élever au-dessus de l’humaine condition. Mais cette force, nous la portons en nous, indéfectible et vivace: c’est elle qui transforme le grossier aliment en influx nerveux et en élément de vie, elle qui anime l’effort physique, le motive et l’idéalise pour le porter à la dignité d’instrument de la spiritualité. Il suffit de ne pas empêcher cette ascèse naturelle, de faciliter au contraire le fonctionnement normal d’un mécanisme auquel nous devons faire rendre tout ce qu’il porte en lui d’étonnantes virtualités.
Nous sommes comme un corps désorganisé qui aurait perdu jusqu’au sens de son équilibre vital, qui ingérerait passivement, sans savoir tirer de ses ingestions les principes dynamiques qui entretiennent et exaltent la vie ; un corps souffreteux pour lequel les fonctions essentielles - dont la satisfaction devrait procurer un naturel bien-être - sont devenues de pénibles corvées qui usent les derniers ressorts de l’être. Il nous faut retrouver l’instinct, rééduquer les diverses pièces de l’organisme, rouvrir les trajets obstrués ou encombrés, rétablir ce circuit qui, par un jeu doux et sans usure, conduit des fonctions primaires jusqu’aux émanations idéales qui sont la splendeur constructive de notre personnalité. I1 n’y aura plus alors fonctions matérielles et viles d’une part, fonction nobles et supérieures d’autre part, mais une unique fonction qui mène à l’exaltation maximum de notre être. C’est cette fonction que nous appellerons travail.
L’ÉDUCATION DU TRAVAIL,
Delachaux et Niestlé,
Neuchâtel, 1960